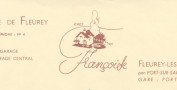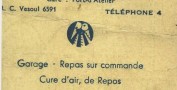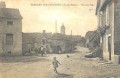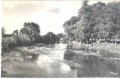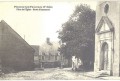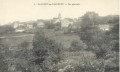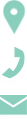Il y avait un moulin banal à aubes, avec son étang derrière pour l'alimentation en eau (en allant sur Amoncourt). Un four à pain banal. Plusieurs fours à chaux hydraulique.
L'abbaye de Faverney avait à Fleurey le droit de justice qu'elle se fit confirmer en 1540, elle possédait la seigneurie dites du haut de Fleurey, celle du bas appartenant en 1485 à Philippe de Genève, puis elle passa à la famille d'Andelot vers 1550 et au XVIII à Jean Bonnefoy conseiller au parlement, seigneur de Rosière.
A l'époque féodale, le four banal, à l'usage de tous, est pourtant le four du seigneur (ce terme volontairement abusif, désigne le titulaire d'un fief noble). Celui-ci y exerce ses droits. On appelle banalités les droits par lesquels le seigneur oblige ses sujets à utiliser, sous peine de ban (amende), ses fours, ses moulins.
On a ainsi découvert, pendant longtemps, dans les terres de la commune des monnaies anciennes datant de cette époque, des fers de lance, des ossements humains. Il ne reste malheureusement rien aujourd'hui de ces témoins du passé, pas plus d'ailleurs que du mystérieux château qui se situait à l'extrémité méridionale de Fleurey. Ce village est très ancien, il est cité sous le nom de Floriacus dans la relation des miracles de Saint Prudent, par Thiébaud, moine de Bèze, relation qui fut rédigée au commencement du XII siècle. Il y a cependant une incertitude dans les récits, car dans le Comté de Port, il y avait trois Fleurey et on ne sait pas toujours duquel on parle. Le mystère reste entier pour le moment.
Ce village fut tellement dépeuplé pendant la peste de 1638 qu'il n'y resta, suivant les traditions locales, qu'un homme et sa fille.
Le tacot (Tramway) passait en gare, au nord-ouest de la commune, et traversait la Lanterne sur le pont de fer.
Ci-dessous figure les activités économiques classé approximativement par date et non exhaustive. ( voir photos illustrant cette rubrique en bas de page ).
- 1) Épicerie : Mme Marie GAVAILLE. Dans le bas du village vers la grande fontaine. Le mari était agriculteur et sa femme tenait l'épicerie. Activité jusqu'a 1925 ?
- 2 ) Menuiserie-Charron : Mr Alfred FAIVRE. Petit atelier de menuiserie au milieu du village de 1900 à 1935. Charron, une personne qui fabrique des charrettes, des chariots, des roues. Le frêne est un excellent bois de charronnage.
- 3 ) Café-Tabac-Téléphone : Mme Berthe FAIVRE son épouse. Petit commerce dans le même bâtiment de 1900 à 1943 environ. A l'époque on grillait encore le café (torréfaction). Ici Berthe le faisait dans un cylindre avec le feu dessous.
- 4 ) Gare du tacot. Dans la période de 1911 à 1924, Denise MARTIN s'occupera de la gare, avant d'ouvrir une épicerie. Puis sera remplacée par Mme GAVAILLE de 19-- à 19-- .
- 5 ) Maréchal Ferrant : Mr Émile GENTILHOMME. Au centre du village, en activité de 1900 à 1924. Après on trouvera en lieu et place une épicerie.
- 6 ) Maréchal Ferrant : Mr COLAS. Dernière maison de la rue de la fontenotte sur la gauche de 1920 à 1935. S'occupait des ferrages de chevaux, de boeufs et posait également les cercles de fer sur les roues de chariot du menuisier-charron. Après 1935 un maréchal ferrant ( Mr VIENNEY ) viendra de Provenchère pour faire ces travaux pendant un certain temps.
- 7 ) D'abord un moulin avant 1915 puis une Scierie : Mr Aimé GAVAILLE père. Dans le bas du village en partant sur Amoncourt, en activité de 1915 jusqu'en 1958 environ. Il y avait également une saboterie tenue par le fils Pierre de 1940 à 1958.
- 8 ) Café-Salle de danse-Boulangerie : Mr Jean GENTILHOMME. Puis Mr BLANCHARD. Et pour finir Mr KIRTZ. Commerce au milieu du village de 1924 à 1945 . La boulangerie se trouvait dans le fond du bâtiment, le pain était cuit au feu de bois. Ce café était plus important que le précèdent car on pouvait y manger, dormir et même y danser à l'occasion de noce. Celui-ci fût repris par Françoise en 1945 ( voir paragraphe n°13 ).
- 9 ) Epicerie-Dépot de pain : Mme Denise MARTIN. Puis sa fille Suzanne COUDRY. Vendait le pain de la boulangerie derrière (famille) et grillait (torréfaction) également du café mais, cette fois ci dans une boule. Cette épicerie se situait juste à coté du café et salle de danse. Activité de 1924 à 1972. Cette épicerie ne fermera pas elle sera reprise. ( paragraphe 18 )
- 10 ) Boulangerie : Mr Camille REUCHET puis son fils Pierre. Situé dans le bas du village vers la fontenotte. Le pain était cuit au feu de bois également. On trouvait aussi une épicerie au rez de chaussé, puis plus tard au 1er étage. Activité de 19-- à 1981 environ.
- 11 ) Artisan Macon : Mr Gilbert JEANBLANC. Activité de 19-- à 1946. Le fils repris l'activité de son père de 1946 à 1970 environ.
- 12 ) Atelier de machine agricole : Mr Jules MAILLOT. Au centre du village, rachète le bâtiment en 1920, alors que l'atelier existe déjà ( mais que faisait-il avant 1920 ? ). Jules fera la fabrication de machines agricoles. Les deux fils; Serge et Daniel reprendront après leur père. Activité de 1920 à 1975 environ . Il y aurait eu jusqu'a 15 ouvriers.
- 13 ) Chez Françoise. De 1945 à 1948 à repris un café déjà existant au milieu du village. Déjà un grand nombre de personne venait danser et faire les noces. Puis de 1948 à 1959 dans un bâtiment neuf construit a la place d'une ancienne ferme de Mr Henry LEFRANC dans le milieu du village. Cette fois toutes les personnes qui avaient 20 ans à ce moment la ou plus se rappelle de l'établissement. Il y avait aussi un fois par semaine du cinéma. Celui-ci était très connu et les gens venaient de loin pour s'amuser.
- 14 ) Garagiste : Mr Constant MONNASSON. A la sortie du village en allant sur Faverney, il y avait un garage et des pompes à essences. Activité de 1947 à 1984.
- 15 ) Plâtrier- Peintre : Mr Guy OGGERO. Se situait au dessus du village. Avec onze ouvriers, une activité de plâtrier, peinture, vitrerie, entre 1946 et 1985. Puis, il y a eu aussi Isolation Franc Comtoise avec 20 ouvriers de 1975 à 1985. L'ensemble des deux activités arrivait à 31 salariés permanent, avec des pointes à 40 par moment .
- 16 ) Fromagerie : Pierre CHOULET et son employé Émile font tourner la fromagerie. Un peu plus tard Émile RACLOT devient son propre patron jusqu'en 1947. A cette époque Camille CHOULET devient le propriétaire des lieux et embauche jusqu'a deux ouvriers. En 1955, le fils Jacques vient travaillé avec son père. En 1978 Camille arrêtera et son fils reprendra avec un ouvrier pour finir en 1991. On y trouvait un excellent fromage qui portait le nom de son propriétaire ( Choulet ).
- 17 ) Maison de Retraite : A ouvert ces portes vers 1959, dans les locaux de l'auberge, pour des cadres d'un centre automobiles tous proche. Une annexe fut construite pour agrandir le bâtiment. Après de longues années, ils fêteront les 40 années de service. Le 1er novembre 2000, les deux bâtiments fermeront définitivement.
- 18 ) Épicerie : Mme Lydie MARION. De 1972 à 1992 . Au centre du village ou il y avait déjà une épicerie ( paragraphe n°9 ).
- 19 ) Entreprise de travaux publics : Mr André MATHIEU. En 1947, André a commencé ,comme carrier (extraction de pierre) sur la commune de Fleurey. Puis en 1978, il crée une société ( carrières et travaux publics ) avec ses enfants. Cette société, emploiera jusqu'a 15 ouvriers en 1988 . Ils effectuaient des travaux : de routes forestières, ponts, chaussées, particuliers ( cours, terrassement ), routes et aménagement divers. Le 1er juin 2000 , la société fût rachetée par une entreprise nationale Jean LEFEVRE. Cependant, il reste les trois carrières. Celle de Villers sur Port est fermée (De 1980 à 1984 ). A Fleurey on extrait toujours de la pierre avec une autorisation exploitation et extension allant jusqu'en 2013. Il sort actuellement 25000 m3/an, mais peux en sortir 70000m3/an. La carrière de Bougnon déjà exploitée de 1983 à 1988, le sera de nouveau de avril 2001 à avril 2026, avec une nouvelle route d'accès .
- 20 ) Aceline Conseil : Mr Bernard PERNET En 1990, Bernard crée la société Aceline-conseil en communication. La société s'arrêtera en novembre 2005.
- 21 ) Gérard ESTIENNEY, Au cours de l'année 1985, Gérard travaillait dans l'entreprise de M OGGERO . Celui-ci partant en retraite, il créa sa propre societe de peinture , papiers peints. En septembre 2007, il prendra également sa retraite.
- 22 ) Gilbert PISTOLET. Entreprise de terrassement, ayant terminé ces activités en 2010.
- 23 ) Il y aurait eu un magasin vers la chevanne, tenue par Mme RENAUD et ou, on pouvait acheté du poisson. Période 1923 ?
- 24 ) Les agriculteurs. j'en ai recencé environ, 32 depuis début 1900 à nos jours. A l'heure actuelle, il reste deux fermes en exercices. A l'époque , ils travaillaient avec des boeufs ou des chevaux.
Mines et Chiroptères
La production des mines de fer de Fleurey avait attiré de la main d' oeuvre et la population du village était de 668 habitants environ ,dans les années 1841 . Cela coïncide avec la pleine prospérité des mines de fer . L'exploitation se faisait par galeries, et fournissait annuellement 3600 quintaux environ de minerai ( pour une valeur d'environ 2134 Francs ), lequel rendait 26% d'une fonte très propre au moulage. Le minerai n'était pas traité sur place mais dans les fourneaux de Varigney. Le transport devait se faire par bateaux ( Petites barges ). C'est la raison pour laquelle un pont vers la Lanterne serait si haut. On trouve encore , sur presque tous les points du territoire de Fleurey, du minerai de fer en petit grains
A l'heure actuelle , les mines sont interdites par arrêté préfectoral depuis octobre 1989 . La raison est simple ,les chauves-souris ( chiroptères ) sont protégées et elles ont pris possession des lieux . C'est un biotope. En effet, les galeries désaffectées donnent désormais refuge à diverses colonies de grand et petit Rhinolophes. le petit Rhinolophe, rare en Haute-Saône, demeure l'espèce prépondérante; on recense également le grand Murin , des Niphargus et quelques autres espèces toutes inscrites dans le livre rouge des espèces menacées en France.
Le grand et le petit Rhinolophe : ces chauves-souris se reconnaissent à leur face très curieuse. En Franche-Comté, trois espèces de rhinolophes ont été observées jusqu'a présent; le grand et le petit Rhinolophe sont les moins rares des trois. En hiver, on les rencontre parfois en grand nombre dans certaines cavités souterraines. L'été, les femelles forment des colonies de reproduction dans les combles des églises.
Le grand Murin : est l'une des plus grandes chauves-souris de nos régions. Sa taille n'excède pourtant pas les 30 centimètres d'envergure ! S'il fréquente les grottes et les mines durant la periode d'hibernation ( hivers ), il n'est pas rare de rencontrer quelques individus suspendus aux charpentes en été. Le grand Murin est un gros mangeur d'insectes qu'il chasse sur de grande distance souvent au raz du sol.
Aide aux Ukrainiens
Ouverture de la Mairie
Lundi et Mercredi de 14h à 18h
Vendredi de 17h à 19h sur Rendez-vous.